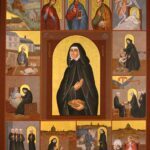« On va vous parler de moi, laissez tomber, le bon Dieu sait tout. »
S’effacer, être oubliée, Jeanne n’a pas d’autre ambition...
Fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres
Par Paul Milcent
La fille d’un pauvre marin (1792-1816)
Une petite maison basse au toit de chaume, au sol de terre battue ; un hameau sur les hauteurs qui dominent la baie de Cancale en Bretagne (France) ; voilà le cadre où naquit Jeanne Jugan le 25 octobre 1792.
1792 : cette date évoque des événements dramatiques. Quelques semaines plus tôt, deux cents prêtres ont été massacrés à Paris parce qu’ils refusaient de prêter le serment exigé par le pouvoir révolutionnaire ; et quelques mois après, le roi Louis XVI sera guillotiné. Déjà, on pressent que l’Ouest de la France va se soulever pour défendre ses traditions, et ce sera, pendant sept ou huit ans, une dure guerre civile. Comme beaucoup d’autres églises, celle de Cancale sera fermée, transformée en magasin à fourrage. Ces événements difficiles vont marquer l’enfance de la petite Jeanne.
Elle sera éprouvée aussi par la mort prématurée de son père. Il était absent lors de sa naissance : parti en mer, pour plusieurs mois, à la grande pêche. D’autres fois, il ne partira pas alors qu’il aurait dû s’embarquer pour gagner un peu d’argent ; mais sa mauvaise santé l’en empêchait. Alors il fallait que la maman travaille, fasse des journées de lessive pour nourrir les enfants – huit en tout, dont quatre sont morts en bas âge. Et puis, un jour, quand Jeanne avait trois ans et demi, le père est reparti ; et il n’est pas revenu. On l’a attendu longtemps, mais il a bien fallu accepter cette quasi-certitude : il avait péri en mer.
La petite Jeanne apprit de sa maman à faire les travaux ménagers, à garder les bêtes, à prier. Il n’y avait plus de catéchisme organisé, mais beaucoup d’enfants, à cette époque, ont été catéchisés en secret par des personnes de leur voisinage, qui avaient acquis une foi personnelle et responsable dans une sorte de tiers ordre fondé par saint Jean Eudes au XVII » siècle. En ces années difficiles, les membres de cet institut, vivant leur vie laïque comme une consécration au Christ, jouèrent un rôle considérable dans la transmission de la foi. C’est sans doute grâce à elles que Jeanne apprit à lire, et parvint à une connaissance nette de la foi chrétienne. Plus tard, elle entrera elle-même dans ce groupement. Vers 15 ou 16 ans, Jeanne fut placée, comme aide-cuisinière, dans une famille des alentours. La maison, qui existe encore, s’appelait la Mettrie-aux-Chouettes. La petite arriva là, toute timide, mais prête à apprendre et à bien faire son nouveau métier. Il semble que Mme de la Chouë l’accueillit affectueusement et l’entoura de sympathie. Au fil des années, elle lui voua même une grande admiration. Car Jeanne ne fut pas seulement employée à la cuisine : elle fut associée au service des pauvres. Elle alla visiter des familles indigentes, des vieillards isolés. Elle apprenait, déjà, le partage, le respect, la tendresse et combien il faut de délicatesse pour ne pas humilier ceux qui ont besoin d’être aidés. Dans ces années-là, un jeune homme la demanda en mariage ; selon l’usage, elle le pria d’attendre. Et elle continua son service, qui était aussi pour elle une école, où elle s’affina. Un peu plus tard, en 1816, eut lieu à Cancale une grande mission : après la terrible tempête de la Révolution, il y avait à reconstruire la foi et l’Église. Jeanne y participa. C’est alors qu’elle décida de se réserver pour le service de Dieu : elle ne se marierait pas. Elle le fit savoir à son prétendant. Elle ne connaissait rien de l’avenir. Et pourtant, un obscur pressentiment, peut-être, l’habitait. En tout cas, elle dit un jour à sa mère : "Dieu me veut pour lui. Il me garde pour une œuvre qui n’est pas connue, pour une œuvre qui n’est pas encore fondée."
Premiers pas vers les pauvres (1817-1823)
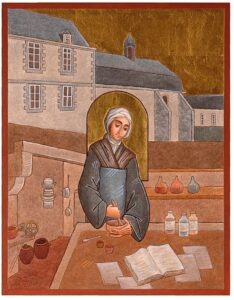
De fait, la ville de Saint-Servan était très déshéritée. Presque la moitié de la population était inscrite au Bureau de Bienfaisance, et de nombreux mendiants assiégeaient les quelques familles plus aisées.
Jeanne entra comme infirmière à l’hôpital du Rosais, trop petit pour accueillir les détresses qui s’y réfugiaient. Car un hôpital, alors, c’était davantage un refuge pour toutes les misères qu’un haut lieu de la science médicale ; et une infirmière n’avait de formation que ce qu’il fallait pour préparer des tisanes, faire des pansements, poser des cataplasmes… Pendant six ans environ, Jeanne se dévoua auprès des trois cents malades qui s’entassaient là, avec trente-cinq enfants trouvés ou abandonnés. Parmi ces pauvres gens teigneux, galeux, vénériens, avec des moyens très insuffisants, le travail était rude, épuisant. Jeanne s’y donna de tout son cœur. On raconte qu’en plus, elle consacra ses moments libres à des initiatives apostoliques ; c’est ainsi qu’elle aurait pris à part un infirmier pour le catéchiser. lle était soutenue par une foi vive. Lors d’une mission qui ranima la vie chrétienne à Saint-Servan en 1817, on créa des congrégations destinées à favoriser une entraide spirituelle, à stimuler la prière et la réflexion chrétienne. Jeanne s’inscrivit à la congrégation des jeunes filles.
Un peu plus tard, elle entra dans un groupement plus exigeant, ce tiers ordre eudiste (ou Société du Cœur de la Mère admirable) qu’elle avait sans doute entrevu dès son enfance par les personnes de foi qui l’avaient catéchisée. Les femmes qui composaient cette société menaient une sorte de vie religieuse à la maison, et s’assemblaient régulièrement pour des réunions de prière et de partage. Elles s’imposaient une discipline de vie et de prière quotidienne. Elles trouvaient surtout là une tradition spirituelle forte, venue de saint Jean Eudes : l’appel à un christianisme du cœur, l’initiation à une foi personnelle et libre, relation vivante avec Jésus Christ. Tout y reposait sur le baptême, dont on renouvelait chaque année les engagements. On cherchait à entrer en communion de pensée, de sentiments, d’intentions, avec le Cœur du Christ et celui de sa Mère, qui ne sont qu’un. "On a toujours sur soi, disait la règle, un petit crucifix : on le prend dans ses mains, on l’embrasse, on le médite ; et il parle à notre cœur …" Les membres de ce groupe apprenaient la liberté intérieure, à base d’« abnégation de leur propre volonté » – afin de savoir aimer en vérité. "Une véritable fille du très saint Cœur de Marie (…) ne demande point à aller à l’église, aux cérémonies religieuses, lorsque sa présence est nécessaire ailleurs (…). D’une charité tendre et active, qui s’étend jusqu'où elle peut (…), elles aiment les pauvres, les simples, parce que Jésus-Christ et la sainte Vierge les ont aimés…" Jeanne fut membre de ce tiers ordre pendant une vingtaine d’années, et il semble qu’elle en ait été profondément marquée. L’esprit du groupement se retrouve dans la première règle ou les usages des Petites Sœurs des Pauvres, surtout sous ses aspects de’ communion vivante avec Jésus, et de renoncement à soi-même, chemin vers la liberté intérieure. Mais nous avions laissé Jeanne à l’hôpital du Rosais, au milieu de ses pauvres malades, dans un grand dénuement de moyens. Au bout de six années, ayant dépassé les limites de ses forces, elle se trouva épuisée et dut quitter son travail.
Un temps de pause et de maturation (1824-1839)
Jeanne trouva à point un nouvel emploi, qui lui fut en même temps un répit bienfaisant : une certaine Mlle Lecoq, de vingt ans son aînée, et qui était sans doute elle aussi membre du tiers ordre, la prit comme servante et comme amie. Toutes deux vécurent pendant douze années une vie commune meublée par la prière, les tâches domestiques d’une existence modeste, la présence aux pauvres, la catéchèse des enfants. Elles participaient chaque jour à la messe, se faisaient mutuellement la lecture, parlaient familièrement de Dieu.
Mlle Lecoq était attentive à la santé de sa compagne, l’obligeait à se ménager, prenait soin d’elle.
Elles vivaient avec leur peuple les bons et les mauvais jours. Et il y eut des jours de misère, en particulier les années 1825-1832 : à la suite d’une grave crise financière à Londres en 1825, de mauvaises récoltes en France les années suivantes, beaucoup de gens connurent la faim. On vit augmenter le nombre des mendiants, et même des hommes sans travail errant par bandes dans la campagne. A Saint-Servan, le nombre des nécessiteux s’accrut encore… Toutes deux y étaient attentives, et prenaient part généreusement aux efforts collectifs déployés pour soulager les détresses. Mais la chère Mlle Lecoq tomba malade et, en juin 1835, elle mourut. Elle laissait à Jeanne ses meubles et une petite somme d’argent. Pour vivre, Jeanne se mit à faire des journées de travail dans des familles de Saint-Servan qui recouraient à elle : ménage, lessive, service de garde-malade… Des liens d’amitié se créèrent ainsi avec un certain nombre de personnes ; ces relations furent par la suite très précieuses à Jeanne et à ceux avec qui elle allait lier son destin.
Jeanne devint l’amie d’une femme nettement plus âgée qu’elle, Françoise Aubert, ou Fanchon. Mettant en commun leurs ressources, elles louèrent un logement au centre de Saint-Servan : deux pièces à l’étage et deux autres aménagées sous les combles. Là, les deux compagnes menèrent une vie rythmée par la prière, assez semblable à celle que Jeanne menait avec Mlle Lecoq. Fanchon filait à la maison ; Jeanne continuait ses journées à l’extérieur.
Mais bientôt, une troisième vint s’adjoindre à elles : une toute jeune fille de 17 ans, une orpheline, nommée Virginie Trédaniel. Celle-ci semble être entrée sans peine dans l’existence priante de ses deux aînées. A partir de cette année1838, elles vont mener toutes les trois – 72, 46 et 17 ans ! – une vie commune régulière, que la mort seule interrompra.
Jeanne était de plus en plus attentive aux pauvres gens qui l’entouraient à Saint-Servan, mais que faire ? Elle se sentait impuissante devant cette immense et multiple détresse… Était-ce assez de se laisser blesser dans son cœur ? Ne faudrait-il pas se laisser blesser dans sa chair ? Ne faudrait-il pas, avec une sorte de folie, partager même le nécessaire, même le chez-soi ? Est-ce que ce ne serait pas cela, aimer ? C’est ce pas-là que Jeanne va maintenant franchir, et elle ne reviendra pas en arrière.
Jeanne donne son lit (1839-1842)
Vers la fin de 1839, peut-être aux premiers froids de l’hiver, Jeanne prit une décision : avec l’accord de Fanchon et de Virginie, elle amena à la maison une vieille femme, Anne Chauvin (veuve Haneau), aveugle et infirme. Jusque-là, cette personne vivait assistée par sa propre sœur ; mais celle-ci, malade, venait d’être hospitalisée : situation désespérée. On raconte que Jeanne, pour lui faire gravir l’étroit escalier de la maison, la porta sur son dos… Ce qui est sûr, c’est qu’elle lui a donné son propre lit, et est montée s’installer elle-même au grenier. Et elle l’adopta pour sa mère.
Peu après, une autre femme âgée, Isabelle Cœuru, vint rejoindre Anne Chauvin. Elle avait servi jusqu’au bout ses vieux maîtres tombés dans la misère, avait dépensé pour eux ses propres économies, puis avait mendié pour les faire vivre. Ils étaient morts, et elle demeurait épuisée et infirme. Jeanne apprit cette belle histoire de fidélité et de partage. Et sans plus tarder, elle l’accueillit au logis ; cette fois, c’est Virginie qui donna son lit et monta s’installer au grenier. Le soir, après avoir soigné leurs deux protégées et dit bonsoir à la bonne Fanchon, Jeanne et Virginie montaient l’échelle qui menait à leur grenier ; et, ôtant leurs souliers pour ne pas faire de bruit, elles achevaient leurs tâches et leurs prières avant de se coucher. Elles étaient trois à travailler (Virginie était couturière) pour l’entretien de cinq personnes, dont deux âgées et malades ; parfois, le soir, après le travail, il fallait veiller pour le raccommodage ou la lessive. Peut-être, dès ce temps, Jeanne commença-t-elle à tendre la main aux familles qu’elle connaissait bien. Virginie avait une amie, à peu près de son âge, Marie Jamet, qui ne tarda pas à faire connaissance avec Jeanne et sa maisonnée. Elle-même vivait chez ses parents et travaillait avec sa mère : elles tenaient un petit commerce. Marie venait souvent retrouver son amie, et elle aussi voua à Jeanne affection et admiration. Toutes trois – et parfois Fanchon avec elles – parlaient de Dieu, des pauvres, des questions que leur posait la vie. Jeanne fit connaître à ses deux jeunes amies son appartenance au tiers ordre eudiste. Elles étaient trop jeunes pour y entrer, mais elles se firent, avec l’aide de Jeanne, un petit règlement de vie inspiré de celui du tiers ordre. Marie et Virginie parlèrent de leur amitié et de leur entraide spirituelle à un jeune vicaire de Saint-Servan, l’abbé Auguste Le Pailleur, qui était leur confesseur. Il les approuva et promit de les aider. Il fit la connaissance de Jeanne, s’intéressa au groupe et à son action bienfaisante. Entreprenant, ingénieux, habile, il était lui-même attentif aux pauvres gens ; il pensa qu’il fallait soutenir ce qui pouvait être le commencement d’une œuvre. Son appui allait être efficace, mais aussi source de quelles épreuves ! Le 15 octobre 1840, avec son aide, les trois amies formèrent une association de charité qui adopta pour loi le petit règlement élaboré par Marie et Virginie. Ce groupe allait rapidement compter un nouveau membre. Une jeune ouvrière de 27 ans, très malade, fut recueillie par Jeanne. Elle pensait mourir… mais elle guérit, et dès lors, participa à l’effort commun. Elle s’appelait Madeleine Bourges. Ainsi, autour des deux femmes âgées accueillies par Jeanne, une petite cellule était née : c’était déjà l’embryon d’une grande congrégation qui s’appellerait, bien plus tard, les Petites Sœurs des Pauvres. En 1840, Jeanne et ses compagnes ne le savaient pas. Mais, déjà, elles rêvaient d’accueillir d’autres misères, d’offrir à d’autres personnes réconfort, sécurité et tendresse. L’argent, Dieu ne le refuserait pas. Mais la maison était pleine : elles décidèrent d’en changer.
La quête (1842-1852)
"Sœur Jeanne, remplacez-nous, quêtez pour nous…" Ainsi parlaient les bonnes vieilles qui avaient longtemps vécu de mendicité. Elles soulignaient par là le cœur même de cette démarche de la quête, qui allait prendre tant de place dans la vie de Jeanne : elle-même allait se substituer aux pauvres, s’identifier à eux ; ou mieux, guidée par l’Esprit de Jésus, elle allait reconnaître en eux sa propre chair (ls 58, 7). Leur détresse était sa détresse, leur quête était sa quête.
Des motifs pratiques l’ont d’ailleurs amenée à quêter elle-même : si elle avait laissé les bonnes femmes (comme on les appelait gentiment) continuer leurs tournées par les rues de la ville, elle les aurait exposées à bien des misères, surtout celles qui s’adonnaient à la boisson. Alors, elle demanda à chacune, avec respect, de lui indiquer les adresses de ses bienfaiteurs, et elle fit la tournée à leur place. Elle expliquait : "Eh bien, Monsieur, ce ne sera plus la petite vieille qui viendra désormais, ce sera moi. Veuillez bien nous continuer votre aumône." On aura remarqué ’ce nous…
Ce ne fut pas facile de prendre cette décision. Jeanne était fière ; certes, elle avait vu jadis à Cancale les femmes de marins s’entraider en tendant la main avec dignité ; mais cela ne suffisait pas pour la faire entrer de gaieté de cœur dans la mendicité. Devenue vieille, elle se rappellera encore cette victoire sur elle-même qu’elle dut bien des fois remporter : "J’allais avec mon panier chercher pour nos pauvres… Cela me coûtait, mais je le faisais pour le bon Dieu et pour nos chers pauvres…" Elle y fut aidée par un Frère de Saint-Jean-de-Dieu, Claude Marie Gandet. Les Frères avaient, dès cette époque, à Dinan, une communauté fervente et un hôpital ; ils tiendront une place importante dans la recherche de Jeanne. Un jour donc, le frère Gandet arriva au grand en-bas ; il quêtait lui-même pour l’hôpital. Il trouva Jeanne dans une grande perplexité. Ils se comprirent, et il l’aida à s’engager délibérément sur le chemin de la quête. Pour lui donner du courage, il lui promit de la seconder et de l’annoncer dans plusieurs familles où lui-même devait passer. On dit même qu’il lui offrit son premier panier de quête. Jeanne se fit donc chercheuse de pain. Elle demandait de l’argent, mais aussi des dons en nature : de la nourriture – les restes de repas ou dessertes seront souvent bien appréciés -, des objets, des vêtements… « Je vous serais bien reconnaissante si vous pouviez me donner une cuiller de sel ou un petit morceau de beurre… Nous aurions besoin d’un chaudron pour cuire le linge… Un peu de laine ou de filasse nous rendrait service… » Elle ne craignait pas de dire sa foi ; si elle venait demander du bois pour la fabrication d’un lit, il lui arrivait de préciser : "Je voudrais un peu de bois pour soulager un membre de Jésus-Christ." Elle n’était pas toujours bien accueillie. Au cours d’une tournée, elle avait sonné chez un vieil homme riche et avare ; elle avait su le persuader, et il lui avait remis une bonne offrande. Elle y retourne le lendemain : cette fois, il se fâche. Elle sourit : "Mon bon monsieur, mes pauvres avaient faim hier, ils ont encore faim aujourd’hui, et demain, ils auront encore faim…" Il donna à nouveau et il promit de continuer. Ainsi, avec le sourire, savait-elle inviter les riches à la réflexion et à la découverte de leurs responsabilités. Un trait est resté célèbre. Un vieux célibataire, irrité, l’avait giflée ; elle répond doucement : "Merci ; cela c’est pour moi. Maintenant, donnez-moi pour mes pauvres, s’il vous plaît !"
Elle allait souvent chercher des secours au Bureau de Bienfaisance de la ville et, dans les premiers temps, on la traitait comme quelqu’un de la maison. Mais un jour, une employée la rudoya, et lui dit de prendre son rang dans la queue parmi les mendiants. Elle obéit. Elle était mendiante, après tout ; c’était sa place. Quand c’était trop dur, elle s’encourageait. Elle disait à sa compagne : "Marchons pour le bon Dieu !" Ou bien, un jour de fête, à Saint-Servan, avec un de ces demi-sourires qui lui étaient familiers : "Aujourd’hui, nous allons faire une bonne quête, parce que nos vieillards ont eu un bon dîner. Saint Joseph doit être content de voir que ses protégés sont bien soignés. Il va nous bénir !" Il semble qu’elle avait une qualité de présence qui impressionnait les gens, une sorte de charme qui opérait sur eux. Un homme qui l’a bien connue a cette jolie formule : « Elle avait un don de parole, une grâce à demander… Elle quêtait en louant Dieu, pour ainsi dire. » Vécue ainsi, la quête se transfigurait. Elle aurait pu provoquer une simple démarche d’assistance, par laquelle les riches se seraient donné bonne conscience ; mais Jeanne en faisait une évangélisation, qui mettait la conscience en question, et invitait à un changement de cœur. Grâce à la quête, l’action de la petite société put s’amplifier. On s’installa sans crainte dans la Maison de la Croix, et au mois de novembre 1842, il y avait là vingt-six vieilles femmes, dont certaines étaient bien malades. Cela demandait beaucoup de travail. Madeleine Bourges vint rejoindre les associées. Elle et Virginie Trédaniel cessèrent leur travail professionnel pour se consacrer entièrement au service des personnes qu’elles avaient accueillies. Peu après, Marie Jamet en fit autant. On ne compta plus que sur la quête pour assurer la subsistance… et achever de payer la maison. Un médecin, qui avait connu Jeanne à l’hôpital du Rosais, fut heureux de la retrouver à la tête de la Maison de la Croix : il accepta de soigner gratuitement les pauvres vieillards, et jusqu’en 1857 il y dépensa un immense dévouement. Un événement important survint durant l’hiver 42-43 : l’entrée du premier vieillard. On avait signalé à Jeanne ce vieux marin, seul et malade dans un caveau humide ; elle le trouva en effet dans un état lamentable, en haillons, sur de la paille pourrie, le visage exténué. Émue de la plus vive compassion, Jeanne s’en fut confier ce qu’elle avait vu à une personne bienfaisante, et revint peu après avec une chemise et des vêtements propres. Elle le lava, le changea et le transporta à la maison. Il y retrouva ses forces. Il s’appelait Rodolphe Laisné. D’autres hommes, sans tarder, sont venus le rejoindre. Parfois, un nouveau concours ou des besoins nouveaux relançaient la quête, ou l’élargissaient. Un jour une certaine Mlle Dubois s’offrit à accompagner Jeanne pour la quête dans la campagne avoisinante. C’était une personne honorablement connue qui se compromettait ainsi en mendiant avec Jeanne. Sa présence frappa l’opinion et les bourses s’ouvrirent plus largement. Outre l’argent, les quêteuses reçurent du blé, du sarrasin, des pommes de terre ; et puis du fil, de la toile… Et des amitiés nouvelles se nouèrent. On fit plus assidûment la quête des dessertes. Parfois on organisait une grande collecte de linge. On instaura la quête des marchés, et aussi, au port de Saint-Malo, celle des navires. On avait contracté, en achetant la Maison de la Croix, une lourde dette de vingt mille francs. Au bout de deux ans et demi, fin 1844, avec sept années d’avance, Jeanne avait tout remboursé. Parfois un don inattendu survenait. Ainsi en fut-il lorsque le neveu d’une ancienne poissonnière de fort mauvaise réputation constata le prodige : accueillie à la Maison de la Croix, elle était devenue une autre femme, avait retrouvé sa dignité. Dans son émerveillement, le brave neveu légua sept mille francs à la maison ; il mourut peu après. Cette somme arriva à temps pour payer la toiture d’un nouveau bâtiment dont la construction avait été entreprise sans aucune réserve : juste une pièce de cinquante centimes qu’on déposa au pied d’une statue de Notre-Dame. Tout le monde s’y mit. Les uns donnèrent des pierres, d’autres du ciment, d’autres des charrois gratuits, d’autres des heures de travail. Les sœurs manièrent la pelle ou la truelle. Et, pour acquitter les trois mille francs qui manquaient, le Prix Montyon survint juste à point. C’était un prix attribué chaque année par l’Académie Française à un Français pauvre, auteur de l’action la plus méritante. Les amis de la maison insistèrent auprès de Jeanne, et elle finit par accepter qu’on le demandât pour elle. Le maire de Saint-Servan et les principaux notables de la ville signèrent une adresse à l’Académie, et le Il décembre 1845, devant un illustre auditoire où figuraient Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Thiers et bien d’autres célébrités, M. Dupin aîné fit un vibrant éloge de l’humble Jeanne. Les journaux en parlèrent. Le discours fut publié. Jeanne se rendit compte que ce discours pourrait lui rendre service : là où elle irait quêter, elle emporterait, comme elle disait, la brochure à l’Académie, et ce serait pour elle une recommandation efficace. Elle allait l’utiliser, de fait, au cours de ses quêtes sur de nouveaux terrains : Rennes, Dinan, Tours, Angers et bien d’autres villes de France.
Cette vie de quêteuse, Jeanne la mena presque sans discontinuer de 1842 à 1852, pendant dix ans. Et jamais elle ne fut déçue par Celui en qui elle avait mis toute sa confiance. A l’étonnement de tous, le nombre des pauvres vieillards croissait sans cesse ; ils étaient bien traités et heureux ; on agrandissait la maison et on allait en acquérir d’autres… avec rien, sans aucune ressource assurée. Aucune autre explication que l’inlassable quête de Jeanne, l’effort collectif de toute une cité stimulée par elle, et sa foi en l’indéfectible amour de Dieu pour ses pauvres.
Les Sœurs des Pauvres
Peu à peu, le petit groupe que formaient Jeanne et ses amies prenait conscience de mener une vie religieuse et s’organisait en conséquence. Elles avaient fait des vœux – vœux privés, pas encore vœux religieux officiels – d’obéissance et de chasteté. Elles portaient déjà quelque chose comme un costume uniforme, inspiré d’ailleurs directement des usages vestimentaires des paysannes de la région. Comme les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, les sœurs portaient sur elles un petit crucifix et une ceinture de cuir. Et puis, elles prirent des « noms de religion » ; Jeanne s’appellerait Sœur Marie de la Croix. En décembre 1843, elle fut réélue supérieure. Mais voici que, deux semaines plus tard, l’abbé Le Pailleur, de sa propre autorité, cassa cette élection et désigna comme supérieure la timide Marie Jamet, âgée de 23 ans, qui était sa pénitente : elle serait plus souple dans sa main que Jeanne Jugan, âgée de 51 ans, forte d’une longue expérience, connue à Saint-Servan depuis vingt-six ans, et qui ne s’adressait pas personnellement à lui. Le prêtre avait décidé : à cette époque, face à un prêtre, qu’auraient pu faire d’humbles femmes ? Elles s’inclinèrent. Mais pour Jeanne, ce ne fut sans doute pas sans douleur ni sans inquiétude… Elles continuèrent leur route. D’ailleurs, à l’extérieur du petit groupe, personne ne sut le changement : Jeanne resta aux yeux de tous garante de l’œuvre entreprise. Au début de l’année 1844, l’association changea de nom officiel : les sœurs choisirent de s’appeler Sœurs des Pauvres, sans doute pour mieux marquer la fraternité évangélique voulue par Jésus et l’intention de partage total, de plain-pied avec ces frères et sœurs. Puis les sœurs firent pour un an les vœux privés de pauvreté et d’hospitalité : ce quatrième vœu – par lequel elles se consacraient à l’accueil des pauvres vieillards – était inspiré directement de l’usage établi chez les Frères de Saint Jean-de-Dieu.
En janvier 1844, Eulalie Jamet avait suivi sa sœur aînée Marie à la Maison de la Croix. A la fin de 1845, une nouvelle sœur se joignit au petit groupe : Françoise Trévily fut la sixième Sœur des Pauvres. Et l’année suivante, une étape décisive allait être franchie : la fondation d’une seconde maison. En janvier 1846, Jeanne partit pour Rennes. Elle y allait quêter à l’intention des pauvres de Saint-Servan. Elle fit annoncer sa quête par les journaux locaux, qui avaient d’ailleurs parlé d’elle un mois plus tôt en donnant l’information du Prix Montyon et du discours de Dupin à l’Académie Française. Dès les premiers jours passés à Rennes, Jeanne y remarqua les mendiants, moins nombreux en proportion qu’à Saint-Servan, mais dont les plus âgés appelaient à l’aide. Il y avait d’ailleurs beaucoup de misère dans les quartiers pauvres de la ville. Très vite, un projet de fondation s’ébaucha dans son esprit et elle demanda l’autorisation de sa supérieure. Dès ce moment, elle rencontra des gens importants, et pas toujours bien disposés. Elle allait de l’avant. "C’est vrai, c’est une folie, ça paraît impossible… Mais si Dieu est pour nous, ça se fera !" Et comment ne serait-il pas pour ses pauvres ? Marie Jamet vint rejoindre Jeanne, qui avait déjà loué à Rennes une vaste chambre flanquée d’une petite pièce. En peu de temps, il y eut dix pensionnaires. Il fallait trouver une maison plus importante. Les deux sœurs cherchèrent, mais en vain. Elles se confièrent à saint Joseph (qui tiendra de plus en plus de place dans la prière des Petites Sœurs des Pauvres). Le 19 mars, jour de sa fête, Marie priait à l’église de Toussaints ; une personne s’approcha : "Avez-vous une maison ? – Pas encore. – J’ai votre affaire… " On alla voir ; la maison, située au faubourg de la Madeleine, pouvait accueillir quarante ou cinquante pauvres, et un pavillon servirait de chapelle. Avec l’accord de Saint-Servan, on signa le contrat le 25 mars, et on s’installa le jour même. Des soldats aidèrent au déménagement et au transport des vieilles femmes. Et la maison continua à grandir, dans la pauvreté. Heureusement, quelques postulantes étaient entrées à Saint-Servan. Il en vint de Rennes, puis d’ailleurs. Jeanne avait repris ses quêtes : Vitré, Fougères… Là où elle passait, elle appelait : il arrivait assez souvent que des jeunes, après son passage, demandent à entrer au noviciat. C’est peut-être à cette époque que Jeanne est allée jusqu’à Redon. Elle a sonné au collège des Eudistes (elle qui était un peu eudiste aussi). Un père a raconté : "J’allai la voir au parloir, et elle m’électrisa (…) Sans plus de façon, je l’introduisis dans l’étude de nos grands pensionnaires, réunis là au nombre de cent environ (…) et Jeanne Jugan exposa bonnement et simplement l’objet de sa mission. Émerveillés et profondément touchés, tous ces élèves vidèrent absolument leurs poches et leurs pupitres… " Depuis plusieurs années déjà, les sœurs avaient bénéficié des conseils du père Félix Massot, ancien provincial de l’Ordre Hospitalier des Frères de Saint-Jean-de-Dieu. Au printemps de 1846, elles préparèrent une règle plus élaborée que le petit règlement primitif. Bien des points de ce texte s’inspirent directement des constitutions des Frères. Mais l’esprit venu de saint Jean Eudes y demeure présent, et s’y reconnaît à plusieurs détails des prières quotidiennes.Un peu plus tard, à la suite d’une quête de Jeanne, une troisième maison s’ouvrit à Dinan, dans une vieille tour des remparts. On ne tarda pas à la quitter pour une maison moins sinistre, puis pour un ancien couvent. Nous retrouverons la vieille tour au chapitre suivant.
Jeanne quêtait toujours. La voici, en janvier 1847, à Saint Brieuc. Un journal local la présente : "Jeanne Jugan, cette fille si dévouée au service des malheureux, qui a fait des miracles de charité et dont les feuilles de la Bretagne ont si souvent retenti l’année dernière, est en ce moment dans nos murs. Elle fait une quête pour son œuvre ; elle se présente chez les personnes charitables et dit seulement : "Je suis Jeanne Jugan." Un pareil nom suffit pour lui faire ouvrir toutes les bourses." Et Jeanne marchait toujours, 'le bissac en bandoulière et le panier à la main', pour mendier au nom des pauvres vieillards. Quelquefois, c’était pour aller au secours d’une des maisons récemment fondées : Saint-Servan, Rennes, Dinan, puis Tours (1849). Car cette œuvre, dont elle s’était vu ôter la direction, à plusieurs reprises elle allait la sauver du désastre, parce que c’est à elle qu’on faisait confiance, et parce que c’est elle qui voyait ce qu’il fallait faire. Elle venait, prenait les mesures nécessaires, obtenait les fonds qui manquaient, encourageait les uns et les autres, puis disparaissait ; on avait besoin d’elle ailleurs. Elle n’avait pas « où reposer sa tête » ; elle semblait n’appartenir à aucune communauté locale déterminée. Pourvu que les pauvres vieillards soient logés, entourés, aimés, elle accepte, elle, d’être sans feu ni lieu.
Un touriste anglais et un journaliste français parlent de Jeanne

"Jeanne nous reçut d’un air bienveillant (…). Elle était simplement mais proprement vêtue d’une robe noire, d’un bonnet et d’un mouchoir blancs ; c’est le costume adopté par la communauté. Elle paraît avoir près de 50 ans, sa taille est moyenne, son teint bruni, et elle semble usée, mais sa physionomie est sereine et pleine de bonté ; on n’y remarque pas le plus petit symptôme de prétention ou d’amour-propre." Une véritable interview se déroula alors entre ce touriste – qui était aussi un homme de bien, occupé précisément à créer un hospice de vieillards – et Jeanne Jugan. Avec simplicité, elle répondit à ses questions. Elle ne savait pas un jour, dit-elle, d’où lui viendraient les provisions du lendemain, mais elle persévérait, avec la ferme persuasion que Dieu n’abandonnerait jamais les pauvres, et elle agissait d’après ce principe certain : que tout ce que l’on fait pour eux, on le fait pour Notre Seigneur Jésus Christ. Je lui demandai comment elle pouvait distinguer ceux qui méritaient vraiment d’être secourus ; elle me répondit qu’elle recevait ceux qui s’adressaient à elle et qui paraissaient les plus dénués ; qu’elle commençait par les vieillards et les infirmes comme étant les plus nécessiteux, et qu’elle s’informait chez leurs voisins de leur caractère, de leurs ressources, etc. Pour ne pas laisser dans l’oisiveté ceux qui pouvaient encore s’occuper à quelque chose, elle leur faisait effilocher et carder de vieux morceaux d’étoffe, puis filer la laine qu’ils en retiraient ; ils arrivaient ainsi à gagner six liards par jour… Ils faisaient aussi d’autres ouvrages, selon leurs possibilités, et recevaient un tiers du petit gain obtenu." Jeanne détailla alors ce qu’elle pouvait attendre des différents fournisseurs : les denrées encore bonnes mais moins faciles à vendre. Je lui ai dit qu’après avoir parcouru la France, elle devrait venir en Angleterre nous apprendre à soigner nos pauvres ; elle me répondit que, Dieu aidant, elle irait si on l’y invitait. Il y a dans cette femme quelque chose de si calme et de si saint qu’en la voyant, je me crus en la présence d’un être supérieur, et ses paroles allaient tellement à mon cœur que mes yeux, je ne sais pourquoi, se remplirent de larmes. Telle est Jeanne Jugan, l’amie des pauvres de la Bretagne, et sa seule vue suffirait pour compenser les horreurs d’un jour et d’une nuit passés sur une mer houleuse."
Deux ans plus tard, un journal de Paris publia un article sur Jeanne et son œuvre : l’Univers, de Louis Veuillot. Le grand journaliste catholique avait eu l’occasion de visiter la maison de Tours récemment fondée. Peu après, il s’était trouvé à l’Assemblée Nationale, lors d’une discussion sur le droit à l’Assistance inscrit dans le préambule de la Constitution de 1848 – qu’il n’aimait pas. Au sortir de cette séance, il écrivit un vibrant article pour présenter aux parlementaires, dit-il, "un personnage plus savant en socialisme que vous ne l’êtes tous" : il s’agissait de Jeanne Jugan. "Elle aimait les pauvres parce qu’elle aimait Dieu. Un jour, elle pria son confesseur de lui enseigner à aimer Dieu davantage encore. "Jeanne, lui dit-il, jusqu’à maintenant vous avez donné aux pauvres ; maintenant, partagez avec eux" (…). Jeanne, le soir même, avait une compagne, ou plutôt une maîtresse (…)". L’article relatait ensuite la visite de Veuillot à la maison de Tours : "J’ai vu des vêtements propres, des visages gais et même des santés charmantes. Entre les jeunes sœurs et ces vieillards, il y a un échange d’affection et de respect, qui réjouit le cœur… Les religieuses s’astreignent en tout au régime de leurs pauvres, et il n’y a nulle différence, sinon qu’elles servent et qu’ils sont servis… Tout arrive à point pour les besoins du moment. Au souper, rien ne reste, au déjeuner rien ne manque. La charité a donné la maison. Lorsque survient un pensionnaire, elle envoie le lit et les vêtements."(L’Univers, 13 septembre 1848). L’Univers avait une assez large diffusion : l’article de Veuillot contribua à faire connaître l’œuvre des Sœurs des Pauvres.
Croissance

Comme l’abbé Le Pailleur, le conseiller de Marie Jamet, avait eu quelques difficultés avec l’évêque de Rennes, on décida d’aller s’installer à la maison de Tours récemment fondée. Les jeunes, à partir de cette date, vont d’ailleurs affluer de plus en plus nombreuses : à l’été 1849, il y en aura déjà quarante. Mais, quelques mois plus tôt, Jeanne Jugan a été appelée par ses sœurs à cette maison de Tours, qu’elle n’avait pas fondée elle-même. Elle y est arrivée en février 1849, surtout dans le but d’obtenir les autorisations officielles, qui faisaient défaut. Elle a été accueillie avec enthousiasme par M. Dupont, généreux et saint laïc, qui avait déployé beaucoup d’efforts et dépensé beaucoup d’argent pour préparer l’installation des sœurs : "Depuis deux jours, écrit-il alors, nous avons l’honneur de posséder Jeanne Jugan, la mère de toutes les Petites Sœurs (…). Quelle admirable confiance en Dieu ! Quel amour de son saint Nom ! Elle va nous faire du bien à Tours. Les grossiers gens du monde croient que cette pauvre chercheuse de pain, comme elle s’appelle, leur demande l’aumône ; mais si leurs yeux s’ouvraient, ils comprendraient, eux, qu’ils en reçoivent une immense en l’entendant parler si amoureusement et si simplement de la Providence de Dieu." On a gardé une lettre de cette période : la jeune Sœur Pauline, de Tours, écrit à l’abbé Le Pailleur (19 février 1849). Elle lui raconte les visites qu’elle a faites aux bienfaiteurs et à l’évêque, en compagnie de ma sœur Jeanne. Ensuite, elles ont vu le curé de la paroisse qui leur a conseillé de retourner chez l’évêque afin de lui demander une lettre de recommandation auprès des curés. Elles y sont allées. Relisons la suite de cette lettre, qui saisit sur le vif "la sœur Jeanne", et son comportement dans la congrégation, dix ans après les premiers débuts. "Monseigneur lui a dit qu’il n’osait pas trop s’avancer. Elle s’est mise à genoux, elle l’a laissé entièrement libre, à sa grande charité. Il en a été touché, et il lui a dit d’attendre quelques jours, et qu’il le ferait (…). Nous voudrions bien que M. d’Outremont (un ami de la maison, membre de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul) serait à Tours pour lui faire mettre un petit mot dans le journal au sujet de ma sœur Jeanne. Elle m’a dit que ce serait bien utile, qu’elle était entrée dans plusieurs boutiques et qu’on avait le cœur dur comme des brosses (…). "Nous avons été voir Mme la Préfète, qui nous a reçues avec bonté, et nous a envoyé le soir même une autorisation dans tout le département, de la part de son mari que nous n’avions pu voir (…). "Je suis bien contente de la sœur Jeanne, elle est bien bonne, elle se plaît bien à Tours, mais elle s’ennuie un peu en pensant qu’elle ne peut pas encore quêter (…). "Je pense que ce sera sœur Catherine qui conviendra pour la quête. Elle plaît bien à ma sœur Jeanne…" Finalement, Jeanne Jugan laissa la maison de Tours consolidée, et bien enracinée dans la population.
Le 1er août, une nouvelle fondation commença : une maison à Paris. Elle avait été demandée par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui avait connu l’œuvre par M. d’Outremont.
A la fin de la même année 1849, deux autres maisons ont pris leur essor : l’une à Besançon, l’autre à Nantes. C’est à Nantes que se répandit le nom de Petites Sœurs des Pauvres, qui devint officiel un peu plus tard. L’intuition populaire avait trouvé le qualificatif qui exprimait au mieux l’intention de Jeanne : excluant toute domination, se faire tout petit pour mieux aimer. Jeanne n’avait pas participé directement aux fondations de Paris, de Besançon ni de Nantes. En revanche, c’est elle qui donna naissance à la maison d’Angers. Voici comment. Poursuivant sa quête inlassable, Jeanne arriva à Angers en décembre 1849, attendue déjà par plusieurs familles. Elle venait tendre la main pour les fondations déjà faites, mais elle eut dès le début (comme à Rennes) la pensée de doter la ville d’Angers – qui lui était si accueillante -d’un asile pour les pauvres vieillards.
Grâce à un prêtre, qui était vicaire général à Rennes, on trouva rapidement une maison, et la fondation se fit en avril 1850. Dans l’intervalle, Jeanne était probablement retournée à Tours avec le produit de sa quête, puis était allée quêter dans d’autres villes. Le 3 avril donc, elle revint à Angers en compagnie de Marie Jamet et de deux jeunes sœurs. L’évêque, Mgr Angebault, les reçut à bras ouverts. Comme ailleurs, elles arrivaient les mains vides : à elles quatre, elles n’avaient que six francs en bourse pour commencer l’établissement. On obtint les autorisations voulues, on s’installa et on se mit à quêter. Deux jours plus tard, Marie repartait pour Tours, "déjà consolée" et accompagnée de deux postulantes angevines. A la fin d’avril, on accueillait les premières personnes âgées. Les dons affluaient, et pourtant, un jour, le beurre manqua. Jeanne vit que les vieillards mangeaient leur pain sec. "Mais c’est le pays du beurre, dit-elle. Comment, vous n’en demandez pas à saint Joseph ?" Elle alluma une veilleuse devant une statue du Père nourricier, fit apporter tous les pots vides et plaça un écriteau : "Bon saint Joseph, envoyez nous du beurre pour nos vieillards !" Les visiteurs s’étonnaient ou s’amusaient de cette candeur ; l’un d’eux exprima un doute – bien raisonnable ! – sur l’efficacité du procédé. Mais, sous ces signes naïfs se cachait une telle foi !… Quelques jours plus tard, un donateur anonyme fit envoyer un lot très important de beurre, et tous les pots furent remplis. Jeanne voulait que la maison des pauvres soit gaie. Portée par le réseau angevin d’amitié, elle vint un jour trouver le colonel qui commandait une unité en garnison à Angers ; elle lui demanda d’envoyer, l’après-midi d’un jour de fête, quelques musiciens du régiment pour la joie de ses bons vieux. « Ma sœur, je vous enverrai toute la musique pour vous faire plaisir et réjouir vos chers vieillards. » Cette fanfare d’Angers semble accompagner d’allégresse l’amour qui se donne et qui suscite l’amour. Jeanne quitta Angers pour d’autres villes, pour d’autres quêtes. Pendant l’hiver 1850-1851, on repère sa trace à Dinan, à Lorient, à Brest. Dans cette dernière ville, elle rencontra une dame d’œuvres, qui ne l’encouragea pas. Jeanne l’écouta, réfléchit et conclut : "Eh bien, ma bonne dame, nous essaierons !" Elle se mit à quêter. Une amie l’accompagnait. Elles arrivèrent à une maison que l’on savait peu accueillante ; sa compagne l’invita à passer outre. Mais Jeanne, saisissant le cordon de la clochette, lui répondit : "Sonnons en Dieu, et Dieu nous bénira." L’aumône fut généreuse. Tandis qu’elle éveillait les gens au sens du partage et collectait leurs dons, Jeanne restait attentive au développement de la famille qui était née d’elle. Après Angers, ce furent les fondations de Bordeaux, Rouen, Nancy. Elle n’y fut d’ailleurs pas directement mêlée. Puis, ce fut la première maison d’Angleterre, dans la banlieue de Londres. Il faut dire que Charles Dickens, quelque temps plus tôt, était venu à Paris ; il y avait visité l’asile récemment fondé par les sœurs. Fort impressionné, il en avait rendu compte dans son hebdomadaire Household Words (14 février 1852) ; après avoir évoqué les origines, il y décrivait la maison de la rue Saint-Jacques : "… Un ancien a les pieds sur une chaufferette, et murmure d’une voix faible qu’il est bien confortable maintenant car il a toujours chaud. Le souvenir du froid des années et du froid des rues est gravé dans sa mémoire mais il est très confortable maintenant, très confortable… " Ce témoignage du romancier contribua à faciliter l’installation des Petites Sœurs des Pauvres dans son pays. Parallèlement à la croissance géographique et numérique – en 1853, il y aura cinq cents sœurs – se faisait un développement de l’institution elle-même : la règle s’amplifie et se précise. Le P. Félix Massot et l’abbé Le Pailleur y ont travaillé ensemble, à Lille, en 1851, pendant trois semaines. Ce projet fut soumis à l’évêque de Rennes et, le 29 mai 1852, Mgr Brossais Saint-Marc signa le décret d’approbation des statuts : dès lors la famille des Petites Sœurs des Pauvres sera dans l’Église une véritable congrégation religieuse. Cette approbation épiscopale faisait de l’abbé Le Pailleur, officiellement, le supérieur général de la congrégation, conjointement avec la supérieure générale Marie Jamet. Il souhaitait être confirmé dans cette fonction, et il fut satisfait. C’est à Rennes qu’il se fixa. En effet, on venait d’acheter à la périphérie de la ville un assez grand domaine appelé La Piletière ; avec l’asile de Rennes, on y installa le noviciat et la maison-mère, qui avaient été précédemment transférés de Tours à Paris. L’évêque y vint le 31 mai présider la prise d’habit de vingt-quatre postulantes, et la profession de dix-sept novices.
"Vous m’avez volé mon œuvre" (1852-1856)

En 1843, il avait donc cassé la réélection de Jeanne Jugan comme supérieure pour confier cette responsabilité à sa fille spirituelle Marie Jamet. Dans les années suivantes, son emprise sur l’œuvre devint de plus en plus grande, tandis que Jeanne, infatigablement, quêtait pour les nouvelles maisons, travaillait directement à deux fondations, accourait pour soutenir et sauver celles qui chancelaient, garantissait par sa présence et son nom la valeur et le dynamisme des initiatives prises en faveur des vieillards démunis. L’approbation épiscopale obtenue, l’installation de la maison-mère à Rennes réalisée, l’abbé Le Pailleur prit une décision qui allait modifier totalement l’existence de Jeanne : il l’appela à la maison-mère. Désormais, elle n’aurait plus de relations suivies avec les bienfaiteurs ni de fonction notable dans la congrégation ; elle vivrait cachée derrière les murs de La Piletière, occupée à d’humbles tâches. Jeanne avait un peu moins de 60 ans, elle était en pleine activité. Elle obéit humblement. Elle devait rester là – à Rennes puis à La Tour Saint-Joseph en Saint-Pern – sans responsabilités, jusqu’à sa mort, c’est-à-dire pendant vingt-sept années. A La Piletière, elle allait vivre toute petite. Elle était désormais "Sœur Marie de la Croix". A l’intérieur de la congrégation, on n’employa plus guère son nom de Jeanne Jugan ; mais au-dehors, il resta vivant dans combien de mémoires !
Elle fut chargée, au début, de diriger le travail manuel des postulantes – fort nombreuses : soixante-quatre en 1853. On a gardé le souvenir de sa bonté, de sa douceur à leur égard. Elle a toujours aimé les jeunes, et elle en a été aimée. Elle ne revendiquait rien, elle vivait pleinement son effacement. Bien plus tard, une sœur a noté : "Jamais je ne lui ai entendu dire la plus petite parole qui pût faire supposer qu’elle avait été la première supérieure générale. Elle parlait avec tant de respect, tant de déférence, de nos premières bonnes Mères (= supérieures). Elle était si petite, si respectueuse dans ses rapports avec elles…" Elle vit mourir à 32 ans une de ses premières sœurs, Virginie Trédaniel. Est-ce cette mort ou sa propre souffrance, ou le souvenir des premières épreuves de la fondation ? … Un jour, elle dit aux postulantes : "Nous avons été greffées dans la Croix."
Cette greffe était bien vivante. L’Église la reconnut comme sienne. Le 9 juillet 1854, le pape Pie IX approuva la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Joie profonde pour la foi de Jeanne.
Pour se faire reconnaître comme fondateur et supérieur général de ce nouvel institut, l’abbé Le Pailleur avait, progressivement, déformé l’histoire des origines. Pendant les trente-six années qui suivirent, les jeunes qui entrèrent dans la congrégation n’apprirent qu’une histoire truquée où Jeanne apparaissait comme la troisième Petite Sœur des Pauvres. L’abbé, lui, se faisait donner des marques de respect tout à fait excessives ; il exerçait sur la congrégation une autorité absolue : tout passait par ses mains ; toute décision était prise par lui ; en toutes choses, il fallait recourir à lui. Mais l’étonnement, voire le scandale, finirent par être perçus en haut lieu. On fit une enquête par décision du Saint Siège. Et en 1890, l’abbé Le Pailleur fut destitué et appelé à Rome, où il acheva ses jours dans un couvent.
Pendant plus de quarante ans, Marie Jamet lui avait été docilement soumise : elle croyait bien faire. Mais elle avait été souvent déchirée entre ce qu’elle pensait être son devoir d’obéissance et le respect de la vérité. Peu avant de mourir, elle a reconnu ; "Ce n’est pas moi qui suis la première Petite Sœur des Pauvres ni la fondatrice de l’Œuvre. C’est Jeanne Jugan qui est la première et la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres."
Jeanne, elle, avait vécu tout cela avec un mélange de douleur et de confiance. Elle était lucide, et ne pouvait approuver ; mais sa foi s’élevait plus haut que ces manœuvres. Elle gardait le cœur assez libre pour dire en plaisantant à l’abbé Le Pailleur ce qu’elle pensait de lui ; "Vous m’avez volé mon œuvre ; mais je vous la cède de bon cœur !"
Pas de revenus fixes ! (1856-1865)
Au printemps de 1856, la vie de Jeanne changea de cadre : elle accompagna le groupe des novices et des postulantes qui vint occuper, avec la maison-mère, un vaste domaine acquis à trente-cinq kilomètres de Rennes : La Tour Saint-Joseph, en Saint-Pern.
Elle y poursuivit son existence toute cachée, et ses humbles tâches. Elle logea, pendant plusieurs années, en compagnie de deux novices, dans une pièce appelée chambre de la cloche.
On la tenait à l’écart de toute responsabilité, de tout honneur. Elle faisait nominalement partie du conseil général de la congrégation, mais jamais on ne l’y appelait. Et pourtant si, un jour, une seule fois, on l’invita à participer à une délibération. Elle y vint. Sa signature en fait foi. C’était le 19 juin 1865. Il s’agissait d’un problème grave pour la vie de l’institut, d’une question qui mettait en cause l’essentiel de la vocation des Petites Sœurs : les exigences de la pauvreté dans la congrégation.
Dès le départ, on avait voulu vivre pauvre avec les pauvres, dépendre entièrement, avec eux, de la charité. Donc, on avait exclu toute source fixe de revenus. La seule propriété était celle des bâtiments d’habitation qui assurait indépendance et sécurité.
En réalité, aucun texte ne précisait cette option. Et il était arrivé, dans les premières années, que la congrégation acceptât quelques rentes fixes ou fondations. Mais, c’était exceptionnel.
Or, voici qu’en 1865 un legs de 4 000 F sous forme de rente échut en faveur de la congrégation. Une fois de plus, la question se posa : fallait-il l’accepter ? Tandis que le Conseil hésitait, un laïc ami, qui aidait à la gestion financière, rappela le principe : "Si vous me permettez de dire humblement mon avis, vous ne devez l’accepter qu’avec l’autorisation d’aliéner la rente pour faire servir ce capital au paiement de votre maison (de Paris). Vous ne devez posséder que les maisons que vous habitez et, pour le reste, vivre de la charité quotidienne. Si les Petites Sœurs passaient pour avoir des rentes, elles perdraient leurs droits à cette charité qui faisait vivre les Israélites dans le désert, et si une fois elles amassaient la manne, la manne se corromprait entre leurs mains comme jadis cela arrivait au peuple de Dieu."Cette remarque était audacieuse : on était en plein essor du capitalisme naissant ; les grandes banques françaises voyaient le jour ; on inventait le carnet de chèques ; et la comtesse de Ségur elle-même écrivait la Fortune de Gaspard ! On ne parlait que de profit, et l’argent était l’objet d’une espèce de religion. Mais les Petites Sœurs des Pauvres, sensibles à l’appel qui leur était adressé, allaient choisir le dépouillement. Elles demandèrent d’abord l’avis de plusieurs évêques. Le conseil général s’assembla. Et c’est alors que l’on convoqua Sœur Marie de la Croix. Elle en fut surprise, effrayée : "Je ne suis qu’une pauvre fille ignorante ; que puis-je dire ?" On insista. "Puisque vous le désirez, je vais obéir." Elle vint donc au conseil. Et elle exprima clairement son avis : il fallait continuer à ne pas accepter de revenus fixes, à dépendre de la charité. C’est cette orientation qui fut adoptée. La circulaire envoyée aux maisons précisait : "La congrégation ne pourra posséder aucune rente, aucun revenu fixe perpétuel" ; et, par suite, "nous refuserons tout legs ou don consistant en rentes ou grevé de fondation de lits ou de messes ou même de toute autre obligation qui demanderait la perpétuité". Et le conseil écrivit au Garde des Sceaux de l’Empire, ministre de la Justice et des Cultes, pour lui notifier cette décision. Le gouvernement en prit acte l’année suivante, et par le fait même, du refus du legs de 4000 F. Un peu plus tard, nous voyons Jeanne inviter les jeunes sœurs à prier "pour qu’on ne cède pas aux instances de ceux qui voudraient nous donner des rentes".
On voit ainsi qu’elle veillait, dans la prière, sur cette congrégation qu’elle avait fait naître et sur le choix de pauvreté qui la livrait à l’amour du Père des Cieux.
Sagesse de Sœur Marie de la Croix (1865-1879)
Les longues années de La Tour Saint-Joseph ne comportent pas beaucoup d’événements. Seulement, de loin en loin, une image : le chapelet à la main, Sœur Marie de la Croix, « droite, appuyée sur un grand bâton (…), parcourait les prés et les bois en remerciant Dieu (…) ; quand elle revoyait de ses vieux amis qui avaient connu quelque chose des commencements de l’œuvre (…), elle chantait son Magnificat. (Elle) était vraiment éloquente en sa simplicité. »
Et puis, égrenées au fil des jours, des paroles de sagesse, souvent imagées, parfois drôles. Un jour, par exemple, elle expliqua aux novices comment il faut se comporter quand on vous dit des choses désagréables : "Il faut être comme un sac de laine, qui reçoit la pierre sans résonner…" "Faire pénitence", qu’est-ce que ça veut dire ? Elle imagine un cas concret : "Deux Petites Sœurs vont en quête ; elles sont chargées ; c’est la pluie, le vent, elles sont mouillées, etc. Si elles acceptent ces incommodités généreusement, avec soumission à la volonté du bon Dieu, elles font pénitence !" – Un jour, elle appela une jeune sœur près de la fenêtre ouverte ; elle lui montra des tailleurs de pierre : "Voyez-vous ces ouvriers qui taillent de la pierre blanche pour la chapelle ? Et comment ils font jolie cette pierre ? Il faut vous laisser tailler ainsi par Notre Seigneur !" Sœur Claire galopait dans un couloir. Jeanne l’arrête : "Vous laissez quelqu’un derrière vous !" La sœur se retourne, intriguée : "Pardon, ma bonne Petite Sœur, je ne vois personne… – Mais si, il y a le bon Dieu ! Il vous laisse courir en avant car Notre Seigneur ne marchait pas si vite et ne s’empressait pas comme vous…" Les souvenirs de ces années-là apportent ainsi, jusqu’à nous, des brassées de formules savoureuses. Plus rares, aussi, quelques faits marquants. Un jour, par exemple, une mère de famille entra à la chapelle avec ses enfants. L’un d’eux ne marchait pas : il avait déjà 4 ou 5 ans, mais il fallait encore le porter. La maman venait prier : souvent elle demandait la guérison du petit. Elle ressortit, l’enfant dans les bras. Elle rencontra Jeanne. Celle-ci le prit, puis le déposa à terre : "Mon petit, tu pèses lourd !" Elle lui mit dans les mains son bâton, et voici qu’il se mit à marcher tout seul : "Petit Jean marche ! Il marche avec le bâton de Jeanne Jugan !"
Les années passaient ; vers 1870, Jeanne quitta la chambre de la cloche pour la chambre de l’infirmerie, qu’elle occupa jusqu’à sa mort, avec trois autres sœurs. Elle était attentive aux événements douloureux de la guerre de 70, au premier Concile du Vatican, trop vite interrompu, à la prise de Rome par les Révolutionnaires qui combattaient pour l’unité de l’Italie. Elle s’intéressait aussi à la vie apostolique, et les prêtres de la maison venaient volontiers, au retour de leurs voyages, lui raconter leurs activités, confier des intentions à sa prière. Celui d’entre eux qui contribua le plus à l’expansion de la congrégation, hors de France – Ernest Lelièvre, prêtre originaire du Nord – aimait venir se recommander à elle.
Elle jouissait de ce qu’elle voyait, de la beauté des fleurs du parc… Un jour elle en montra une à une jeune sœur : "Savez-vous qui a fait cela ?" – "C’est Dieu", répondit la sœur. Jeanne la fixa du regard, et dit avec émerveillement : "C’est notre Époux !"
La part de la prière devenait de plus en plus grande dans ses journées. Sa piété eucharistique, sa dévotion à la Passion du Sauveur – et au chemin de la croix -, son amour pour la Vierge Marie n’échappaient pas aux novices. Plusieurs ont été frappées de son comportement rayonnant de joie et d’attention aimante, lorsqu’elle faisait le signe de la croix ou s’approchait de la communion sacramentelle. La regarder « faisait désirer d’aimer l’Eucharistie comme elle l’aimait ». D’autres ont noté sa tendresse évidente pour Marie : "C’était un plaisir de la voir prier avec son chapelet. Elle aimait à dire : "Par l’Ave Maria, nous irons en Paradis !" "Elle vivait en présence de Dieu et nous en parlait toujours", dit une novice de ce temps. Parler de la prière lui était familier. Elle avait des formules pittoresques pour baliser les chemins de la vie spirituelle : "Il faut être bien petite devant le bon Dieu. Quand vous faites oraison, commencez par là. Tenez-vous devant le bon Dieu comme une petite grenouille." Ou bien, pour les heures difficiles (et il y a là, sans doute, quelque chose comme une confidence) : "Allez le trouver quand vous serez à bout de patience et de force, quand vous vous sentirez seule et impuissante ; Jésus vous attend à la chapelle ; dites-lui : "Vous savez bien ce qui se passe, mon bon Jésus, je n’ai que vous qui savez tout. Venez, à mon aide." Et puis, allez, et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous pourrez faire ; il suffit que vous l’ayez dit au bon Dieu, il a bonne mémoire… ".
A propos de prière, elle invitait aussi à la discrétion dans la récitation des formules. Lorsqu’elle priait avec les novices, "elle insistait souvent pour que, plus tard, nous veillions à ne pas trop multiplier ces prières de dévotion : "Vous lasserez vos vieillards, disait-elle, ils s’ennuieront, et ils s’en iront fumer… même pendant le chapelet ! "Elle aimait, ainsi, faire part aux jeunes de son expérience dans le service des personnes âgées. "Mes petites, il faut toujours être de bonne humeur ; nos petits vieillards n’aiment pas les figures tristes !" Quand elle parlait des pauvres, son cœur débordait… "Mes petits enfants, disait-elle, aimons beaucoup le bon Dieu, et le Pauvre en Lui… Il faut, dans nos bons vieillards, voir Jésus avec esprit de foi ; car c’est les porte-voix du bon Dieu." Elle donnait aux sœurs des conseils très simples, et pourtant si denses : "Il ne faut pas craindre sa peine pour faire la cuisine comme pour les soigner quand ils sont malades. Être comme une mère pour ceux qui sont reconnaissants et pour ceux qui ne savent pas reconnaître tout ce que vous faites pour eux. Dites en vous-mêmes : "C’est pour Vous, mon Jésus ! " Regardez le Pauvre avec compassion, et Jésus vous regardera avec bonté à votre dernier jour… " Et souvent, elle revenait à la quête : "N’ayez pas peur de vous dévouer et de mendier comme je l’ai fait pour les pauvres, car ils sont les membres souffrants de Notre Seigneur." Elle avait toujours agi avec réflexion, et elle en savait le prix. "Mes petites, il faut prier et réfléchir avant d’agir. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Je pesais toutes mes paroles." Elle qui a si peu parlé d’elle-même, nous livre là un de ses secrets. Un autre secret, c’est l’amour de la petitesse : "Soyez petites, petites, petites ; si vous deveniez grandes et fières, la congrégation tomberait !" – "Seuls les petits plaisent à Dieu… " A 80 ans, elle gardait fière allure. Une jeune femme anglaise l’a décrite alors, "marchant d’un pas ferme, une main appuyée sur l’épaule d’une jeune sœur, l’autre sur un solide bâton, si droite et si alerte (…) dans les belles allées. Ce qui nous frappa surtout, ce fut la grande douceur de son sourire…" Parfois, avec les novices, elle commentait en souriant une lecture. Il avait été question des saintes larmes ; elle fit fermer le livre, et dit aux sœurs : "Il y en a qui ont peut-être de la peine à entendre cela, et qui disent : "Moi, je ne peux pas pleurer… Je ne voudrais pas non plus être toujours à pleurer…" Ne vous inquiétez pas pour les saintes larmes ! Il n’est pas nécessaire d’en verser et de mouiller ses yeux. Mais faire un sacrifice de bon cœur, recevoir une réprimande en paix, cela compte pour de saintes larmes. Je suis sûre que vous en avez déjà pleuré ainsi plusieurs fois aujourd’hui…" Sagesse, équilibre, bienveillance : Jeanne Jugan est là. Peu à peu, sa vue s’affaiblissait, ses paupières se paralysaient. Dans ses dernières années, elle était presque aveugle. Elle disait : "Quand vous serez vieilles, vous ne verrez plus rien. Moi, je ne vois plus que le bon Dieu." Ou encore : "Le bon Dieu me voit, cela suffit !" Cela ne l’empêchait pas d’être gaie, de raconter des histoires drôles, des souvenirs amusants. Elle racontait, par exemple, comment un lapin, un jour, bondit hors de son panier et comment des gamins le rattrapèrent à la course : elle leur donna deux sous pour prix de leur peine ! Un jour de Pâques, elle s’approcha d’un groupe de sœurs qui répétaient des chants. "Allons, mes petites, chantons la gloire de notre Jésus ressuscité !" Et la voilà qui, des deux bras, donnait le rythme en chantant Alléluia avec une telle ardeur qu’elle paraissait vouloir "quitter son vieux corps pour suivre son Jésus !" Quel entrain, quelle jeunesse ! Elle était habitée par une action de grâce continuelle : "En tout, partout, en toute circonstance, je répète : Dieu soit béni !" Jusqu’à la fin, elle a aimé chanter : des chansons, ou des espèces de comptines qu’elle avait peut-être composées elle-même : "Le pauvre nous appelle. De la voix et du cœur ; 0 la bonne nouvelle ! Partons avec bonheur." Ou bien : "Montrez-vous toujours faciles, Ne refusez rien. Pour des petites cherche-pain. Tout est toujours bien !" Ou encore : "0 Jésus, Roi des Élus, Qui vous aimera le plus ?" Il semble que l’union profonde et simple qu’elle vivait avec Dieu de plus en plus, dans le dépouillement croissant de l’âge, avait en elle libéré la joie.
De la mort à la vie (1879)
Dans les dernières années de sa vie, Jeanne parlait assez souvent de sa mort ; elle en parlait avec sérénité. Un jour, elle dit à une jeune sœur qui était venue lui faire un brin de conversation : "Chantez-moi le refrain : Oh ! pourquoi sur la rive étrangère prolongerais-je mon séjour ?" Elle disait parfois : "Je voudrais bien mourir… – II ne faut pas mourir, lui répondait-on. – Si, je voudrais bien : pour aller voir le bon Dieu." Mais avant de partir, elle devait connaître une dernière joie. En novembre 1878, des démarches avaient été entreprises pour obtenir du pape l’approbation des constitutions (l’approbation de 1854 était seulement ad experimentum). Le 1er mars 1879, Léon XIII accorda la confirmation demandée. Il y avait alors, quarante ans après les humbles commencements de Saint-Servan, 2400 Petites Sœurs. Jeanne avait achevé son œuvre et sa longue mission de prière. Elle pouvait partir. Un matin du mois d’août 1879, elle eut un malaise. On lui donna le sacrement des malades. Elle pria à mi-voix : "0 Marie, vous savez que vous êtes ma mère, ne m’abandonnez pas !… Père éternel, ouvrez vos portes, aujourd’hui, à la plus misérable de vos petites filles, mais qui a si grande envie de vous voir !…" Puis, d’une voix plus faible : "0 Marie ma bonne mère, venez à moi. Vous savez que je vous aime et que j’ai bien envie de vous voir !…" Puis elle s’éteignit doucement. Les témoins ont noté l’immense paix qui émanait de son visage. Elle avait achevé de se remettre, avec et parmi les pauvres, aux très douces mains de notre Père.
Sa mission continue
"On va vous parler de moi, laissez tomber, le bon Dieu sait tout." Dernier conseil de Jeanne, le 19 mars 1876, à une jeune sœur, professe depuis trois jours, qui va quitter La Tour Saint-Joseph pour Saint-Servan. S’effacer, être oubliée, Jeanne n’a pas d’autre ambition. A sa mort, cette ambition semble réalisée. Et pourtant ! En 1894, celle qui est appelée à guider la congrégation après la mort de Marie Jamet entreprend d’en faire écrire l’histoire. Ce premier travail de recherche historique paraît en 1902. Il a été précédé, trois ans auparavant, par une brève notice nécrologique de Jeanne Jugan : elle y est reconnue comme la première Petite Sœur et fondatrice. Avec la restitution de son œuvre, la mission posthume de Jeanne commence : elle ira s’amplifiant au cours des années. En 1935, les nombreux témoignages de ses contemporains font penser le moment venu d’ouvrir, à Rennes, le procès informatif sur sa réputation de sainteté. L’année suivante, les restes de Jeanne sont transportés du cimetière de la communauté à la crypte de la chapelle. La seconde guerre mondiale vient interrompre la procédure ; il faudra attendre juillet 1970 pour introduire la cause à Rome. Tous les témoins oculaires ont alors disparu. Le procès apostolique devra donc porter un jugement sur l’héroïcité des vertus de Jeanne à partir d’un travail historique. Celui-ci est terminé en février 1979, présenté à Jean-Paul II, et le décret d’héroïcité des vertus est promulgué le 13 juillet suivant, six semaines avant le centenaire de la mort de Jeanne Jugan.
Trois ans plus tard, le caractère médicalement inexplicable d’une guérison est reconnu : Antoine Schlatter, résident de la maison des Petites Sœurs des Pauvres de Toulon (France), atteint de la maladie de Raynaud à un stade avancé, et menacé de l’amputation d’une main, a été subitement guéri au cours d’une neuvaine de prière par l’intercession de Jeanne Jugan. En la proclamant Bienheureuse, le 3 octobre 1982, l’Église proposait Jeanne Jugan en exemple à notre temps. Quel est donc son message ? Un siècle et plus après sa mort, peut-il être encore actuel ? Précurseur dans le domaine de l’action apostolique et sociale, voici un siècle et demi, Jeanne eut un sens humain et évangélique du grand âge qui n’est pas lié à son époque. Par son œuvre hospitalière au service des personnes âgées pauvres, établie aujourd’hui dans trente et un pays, elle nous invite à considérer dans l’optique de Dieu la place et le rôle des aînés dans nos sociétés modernes, leur insertion dans la famille et dans l’Église, l’apport unique de cet âge, ses richesses comme ses difficultés. Elle nous convie à l’attitude essentielle d’estime, de compréhension mutuelle, d’échange, de partage et d’entraide qui doit relier les générations. Mais le message de Jeanne Jugan ne s’arrête pas là. Une personne qui l’a bien connue a dit que son caractère particulier était la louange de Dieu. Contredite, humiliée, en butte aux adversités, "elle allait toujours louant Dieu". Cette louange prenait racine dans sa foi. Pauvre avec les pauvres, heureuse de l’être, Jeanne faisait une confiance absolue à la bonté paternelle de Dieu, s’abandonnait aux chemins de sa Providence, se savait une servante inutile et proclamait sa joie de tout attendre du bon Dieu. Jeanne Jugan est un appel à vivre les Béatitudes aujourd’hui. Sa mission continue. Une mission authentifiée par le pape Jean-Paul II en présence de milliers de pèlerins venus à Rome célébrer sa béatification. "La lecture attentive de la Positio sur les vertus de Jeanne Jugan, comme les récentes biographies consacrées à sa personne et à son épopée de charité évangélique, m’inclinent à dire que Dieu ne pouvait glorifier plus humble servante", soulignait Jean-Paul II dans l’homélie de la messe du 3 octobre 1982. Jeanne, poursuivait-il, nous invite tous – et je cite les termes de la Règle des Petites Sœurs – "à communier à la béatitude de la pauvreté spirituelle, acheminant vers le dépouillement total qui livre une âme à Dieu". Elle nous y invite beaucoup plus par sa vie que par les quelques paroles conservées d’elle et marquées du sceau de l’Esprit Saint (…). Dans sa longue retraite à La Tour Saint-Joseph, elle exerça certainement sur de nombreuses générations de novices et de Petites Sœurs une influence décisive, imprimant son esprit à la Congrégation par le rayonnement silencieux et éloquent de sa vie. A notre époque, l’orgueil, la recherche de l’efficacité, la tentation des moyens puissants ont facilement cours dans le monde et parfois, hélas ! dans l’Église. Ils font obstacle à l’avènement du royaume de Dieu. C’est pourquoi la physionomie spirituelle de Jeanne Jugan est capable d’attirer les disciples du Christ et de remplir leurs cœurs de simplicité et d’humilité, d’espérance et de joie évangélique, puisées en Dieu et dans l’oubli de soi…" Après avoir médité sur l’actualité du message spirituel de Jeanne Jugan, Jean-Paul II mettait en lumière le message apostolique non moins actuel qu’elle nous a également laissé. « On peut dire qu’elle avait reçu de l’Esprit comme une intuition prophétique des besoins et des aspirations profondes des personnes âgées (…). Sans avoir lu et médité les beaux textes de Gaudium et spes, Jeanne était en accord secret avec ce qu’ils disent de l’établissement d’une grande famille humaine où tous les hommes se traitent comme des frères (n. 24) et partagent les biens de la création selon la règle de la justice, inséparable de la charité (n. 69) (…). Dès les premières années, la Fondatrice a voulu que sa Congrégation, loin de se limiter à l’Ouest de la France, devienne un véritable réseau de maisons familiales, où chaque personne soit accueillie, honorée, et même – selon les possibilités individuelles – promue à un épanouissement de son existence (…). L’Église tout entière et la société elle-même ne peuvent qu’admirer et applaudir la merveilleuse croissance de la toute petite semence évangélique jetée en terre bretonne (…) par la très humble Cancalaise, si pauvre de biens, mais si riche de foi !…"
"Demeurez dans l’admiration et l’action de grâce, à cause de la bienheureuse Jeanne, à cause de sa vie si humble et si féconde, véritablement devenue un des nombreux signes de la présence de Dieu dans l’histoire…" "Signe de la présence de Dieu dans l’histoire". Que cette parole du pape éclaire la route de ceux et celles qui ont mis leur confiance en Jeanne Jugan, l’humble Petite Sœur Marie de la Croix !